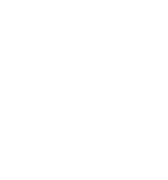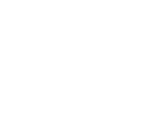APPROFONDISSEMENTS
Le processus inflammatoire

Lorsque l’on souffre d’une infection des voies respiratoires, comme un rhume banal ou une grippe, un des principaux symptômes qui apparaît est le “nez bouché” qui s’accompagne d’une certaine gêne respiratoire. Bien que nous soyons amenés à penser que l’obstruction des cavités nasales soit due à l’excès de mucus, cela n’est vrai qu’en partie : en effet, en cas de gêne respiratoire, il convient d’attribuer un rôle au moins égal à la congestion nasale, qui à son tour est symptôme d’une inflammation en cours.
L’inflammation est un des mécanismes de défense de l’organisme. Le fonctionnement du processus inflammatoire se base sur une série de modifications de la microcirculation sanguine dans la région soumise à l’infection et sur le passage consécutif dans le tissu inflammatoire des cellules sanguines qui combattent les agents pathogènes.
L’afflux de sang vers la partie du corps infectée augmente considérablement tandis que le flux en sortie diminue, de façon à permettre un réapprovisionnement suffisant de la zone en substances anti-pathogènes ; ces substances sortent des vaisseaux sanguins pour se déverser sur les tissus et repousser les menaces, en sécrétant l’histamine et d’autres substances qui jouent le rôle de médiateurs et régulent l’afflux dans son ensemble.
En raison de ce processus, la région concernée se caractérise par des rougeurs, par un gonflement du tissu infecté (connu également sous le nom d’œdème), par une élévation de la température corporelle (qui pourrait se transformer en une véritable fièvre) et par des douleurs.
Une fois le danger que représente l’infection écarté, le flux sanguin diminue, les cellules sanguines impliquées sont drainées par le tissu qui désenfle, la température se régularise et la douleur disparaît. L’inflammation provoque un certain malaise et des désagréments indéniables, mais grâce à eux, il est possible de disposer d’une réponse adaptée aux infections et de rétablir l’équilibre de l’organisme.